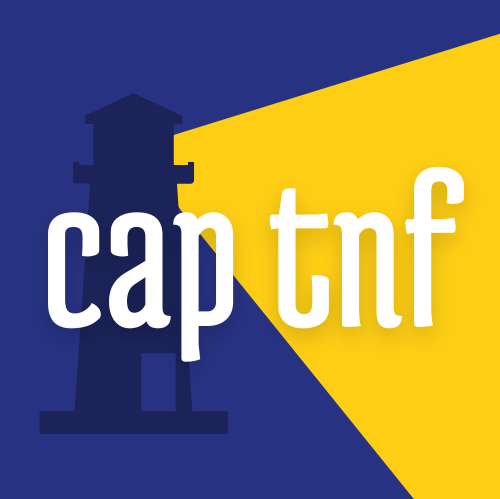Il a été suggéré que l’hystérie avait disparue et n’était qu’un concept ancien, stigmatisant et péjoratif, voire erroné, reflétant l’incapacité de la communauté médicale à établir parfois un diagnostic. Actuellement ces troubles, appelés troubles dissociatifs, de conversion ou encore troubles neurologiques fonctionnels, restent pourtant une réalité clinique fréquente et invalidante pour les patients. Plusieurs études et revues ont tenté de mieux décrire la présentation clinique, mais également de mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques impliqués dans ces troubles grâce au développement de certaines techniques d’imagerie cérébrale. Si les corrélats neurobiologiques sont mieux compris, des traitements efficaces manquent encore et seule une prise en charge multidisciplinaire (généralistes, neurologues, psychiatres, kinésithérapeutes etc…) et individualisée peut apporter un bénéfice au patient.
Introduction
Tout médecin est confronté au cours de sa carrière à un certain nombre de patients pour lesquels un diagnostic précis ne peut être établi. Pour une partie d’entre eux, le temps permet d’obtenir un diagnostic avec l’apparition de symptômes et signes plus clairs. Pour d’autres, la cause des symptômes reste inconnue et si les troubles persistent au moins six mois, la terminologie qui s’impose le plus souvent est celle de troubles somatoformes indifférenciés (tableau). Lorsque la présentation clinique est d’ordre neurologique (c’est-à-dire qu’elle comprend un trouble moteur, sensitif ou sensoriel), on parle de troubles de conversion, toujours selon le DSM-IV. On reste alors jusqu’ici dans un registre descriptif, bien que le terme de «conversion» fasse référence aux théories freudiennes d’une transformation de conflits psychiques en symptômes physiques.

Présentation clinique: symptômes et signes « pseudo-neurologiques »
Le trouble dissociatif se présente sous forme d’un syndrome « pseudo-neurologique » pouvant mimer une atteinte motrice, sensitive ou sensorielle, des crises de type épileptique ou des mouvements anormaux, dont les troubles de la marche. Le diagnostic ne repose pas que sur l’absence de signes pathologiques en relation avec les symptômes ; si un patient présente une hémiparésie, il est entendu que des signes cortico-spinaux de ce même côté seront exclusifs d’un trouble de conversion. Par contre, il est possible de trouver d’autres anomalies à l’examen neurologique et ceci n’exclut pas un diagnostic de syndrome de conversion ; un patient peut présenter des signes cortico-spinaux séquellaires d’un ancien accident vasculaire cérébral et remplir les critères cliniques pour un tremblement dissociatif.
D’autre part, le diagnostic repose sur la présence de signes dits « positifs » qui, lorsqu’ils sont présents, suggèrent fortement le diagnostic de trouble dissociatifs. Si certains de ces signes (dont quelques exemples sont décrits ci-dessous) ont été validés, la plupart n’ont pas de spécificité ni de sensibilité établies. C’est donc l’ensemble du tableau clinique qui permet au neurologue d’établir le diagnostic, en évitant de restreindre ce dernier à un diagnostic d’exclusion. Récemment, une revue de toutes les études a pu établir que le taux d’erreur diagnostique était de 4%, ce qui est comparable à d’autres maladies neurologiques telles que les maladies du motoneurone (6%), ou psychiatriques comme la schizophrénie (8%).
Troubles moteurs dissociatifs
Le trouble moteur dissociatif est retenu lorsque l’on observe des signes d’incohérence : par exemple un patient est paralysé au niveau de sa jambe droite lors de l’examen au lit mais est capable de rester debout sur cette jambe lorsqu’il remet son pantalon en fin d’examen. La présence de lâchages, lors de l’examen, de la force est également suggestive : le patient peut développer une bonne force, mais celle-ci n’est pas soutenue et, contre résistance, la force lâche (sans qu’une douleur ou qu’une pathologie n’en soient la cause).
Troubles sensitifs dissociatifs
Les troubles sensitifs dissociatifs sont également suggérés lorsqu’il existe des incohérences : un patient atteint d’anesthésie complète à tous les modes au niveau des jambes (y compris le sens de position) ne devrait pas présenter un test de Romberg normal ou une marche normale. La présence d’un déficit sensitif dans un territoire non organique suggère aussi le diagnostic: par exemple, une anesthésie sur une hémi jambe, ce qui ne correspond ni au territoire d’une racine nerveuse ni à celui d’un tronc nerveux (comme la sciatique), ni à la représentation corticale cérébrale du territoire de la jambe.
Troubles dissociatifs convulsifs
Les troubles dissociatifs convulsifs (crises non épileptiques psychogènes ou CNEP) peuvent être diagnostiqués lorsqu’ils sont enregistrés de façon simultanée à un électro-encéphalogramme et que celui-ci ne montre aucune activité épileptique durant la crise. Certains signes cliniques sont très fortement suggestifs comme le balancement du bassin ; les mouvements latéraux de la tête (type non-non) ; l’arc de cercle en type de contraction ; le début lent et progressif ainsi que la longue durée de la crise et finalement les yeux fermés (ils restent ouverts lors d’une crise épileptique généralisée). Ce dernier signe a été validé et montre une valeur prédictive positive de 0,94 (sensibilité 96% et spécificité 98%).
Troubles de la marche dissociatifs
Les troubles de la marche dissociatifs sont reconnus lorsqu’il existe une caractéristique typique, comme « la marche du patineur », le patient glissant les pieds comme sur de la glace, ou lorsqu’il existe une position non économique: le patient maintient son centre de gravité dans une position demandant un effort supplémentaire (ex : marche genoux fléchis qui demande, en plus d’un bon équilibre, une force considérable des quadriceps).
Tremblement et troubles sensoriels dissociatifs
Le tremblement dissociatif (le plus fréquent des mouvements anormaux dissociatifs) est reconnu lorsqu’il est variable, qu’il change lorsque le sujet est distrait ou qu’il est entraîné par une autre fréquence (lors d’un mouvement rythmique de l’autre main, par exemple). On peut enfin mentionner les troubles sensoriels dissociatifs : surdité, cécité pour lesquels le concours des spécialistes ophtalmologues et ORL est bien souvent nécessaire.
Hystérie : un concept historique ?
Dans l’Antiquité, Hippocrate a consacré plusieurs chapitres de ses Traités de médecine à décrire les symptômes de l’hystérie et leurs traitements. Ce n’est ensuite qu’au XIXème siècle qu’un intérêt renaît dans la communauté médicale pour cette présentation clinique intrigante par le biais de Jean-Martin Charcot, qui assied sa renommée, en partie, en présentant des patientes en «grande crise hystérique» lors de ses légendaires Leçons du Mardi. Par la suite, un de ses élèves, Sigmund Freud, va développer le concept de conflit psychique en un symptôme somatique. Puis on assiste au siècle passé à une mise à l’écart de cette pathologie, tant de la part des psychiatres que des neurologues, au point où il est même suggéré que l’hystérie n’existe plus. L’élargissement du spectre des diagnostics psychiatriques, comme les troubles de la personnalité, apporte de plus une confusion avec notamment le concept de personnalité histrionique.
Avec l’avènement de nouvelles techniques comme l’électrophysiologie et l’imagerie cérébrale, l’intérêt renaît ces dernières décennies et il a été récemment établi que l’hystérie, rebaptisée troubles de conversion ou troubles dissociatifs, ou plus simplement dans le langage utilisé auprès du patient, troubles fonctionnels (la fonction est perturbée, mais l’organe est sain), reste de nos jours une pathologie fréquente et invalidante. On estime que jusqu’à 30% des patients d’une consultation de neurologie générale présentent des symptômes médicalement inexpliqués et leur suivi montre que plus de la moitié (55%) ne font l’objet d’aucune amélioration à huit mois d’évolution. Le suivi à long terme de patients présentant un syndrome moteur et/ou sensitif dissociatif a montré que douze ans plus tard, 83% d’entre eux restent symptomatiques et près de 30% ont cessés toute activité professionnelle à un âge moyen de 44 ans.
Symptômes neurologiques médicalement inexpliqués : un diagnostic manqué?
Une des raisons pour lesquelles un courant de pensée soutenant que l’hystérie avait disparu s’est instaurée, est qu’il était entendu qu’il s’agissait tout simplement d’erreurs diagnostiques. En 1965, une étude a suggéré que si on suivait à long terme ces patients, une maladie organique était en fait découverte dans deux cas sur trois à dix ans. Une récente méta-analyse de 27 études de 1965 à 2005 a montré que le taux d’erreur diagnostique semble diminuer avec les années mais ceci est expliqué par l’amélioration de la méthodologie des études et non pas des progrès de la médecine (comme l’apparition du scanner cérébral par exemple). On estime actuellement que le taux d’erreur diagnostique dans les troubles de conversion est de 4%, ce qui est comparable à d’autres maladies psychiatriques (schizophrénie : 8%) et neurologiques (maladie du motoneurone : 6%).
Si on sait maintenant qu’un diagnostic peut être posé de façon aussi certaine que pour d’autres maladies, il est évident que celui-ci repose sur des critères qui doivent être les plus objectifs possibles, sachant qu’il s’agit d’un diagnostic clinique et qu’aucun marqueur biologique n’est disponible. Dans ce sens, un effort important de validation de signes cliniques et paracliniques (dont les plus importants sont rapportés ci-dessous) a été fait et continue de susciter des recherches.
Pour étayer le diagnostic de trouble dissociatif convulsif (ou crise fonctionnelle dissociative – CFD) le fait que les yeux soient fermés pendant la crise est un excellent signe clinique amenant une valeur prédictive positive (spécificité de 98% et sensibilité de 96%). Lorsque le clinicien suspecte une CNEP, par exemple en raison d’une présentation atypique (durée très longue, mouvements asynchrones, etc.), la pratique d’un enregistrement électroencéphalographique de 24 à 72 heures permet d’obtenir un diagnostic de certitude dans 73% des cas. Le dosage de la prolactine sanguine 20-30 minutes après la crise permet de faire la différence entre une CFD et une crise épileptique avec perte de contact (généralisée ou partielle complexe, spécificité de 60% et 46% respectivement et sensibilité de 96% pour les deux). La présence d’une respiration stertoreuse, lorsqu’elle est bien documentée, permet également de trancher en faveur d’une crise épileptique.
Pour les troubles dissociatifs moteurs, on recherche cliniquement le signe de Hoover (mouvement d’extension automatique de la jambe malade qui est senti par l’examinateur pendant un mouvement de flexion forcé de la jambe saine ; basé sur le réflexe de marche), dont une version a montré que le mouvement automatique involontaire était nettement plus marqué lors de parésie dissociative que lors de parésie organique.
Concernant les mouvements anormaux, des critères diagnostiques cliniques ont été récemment modifiés et, malgré un dessin d’étude rétrospectif, leur validation a montré une spécificité de 100% et une sensibilité de 83% pour détecter un mouvement anormal psychogène «certain» ou «probable». Ces critères reposent sur les caractéristiques de début brusque, distractibilité, inconsistance, faiblesse ou trouble sensitif associé, somatisation associée, douleur ou fatigue, bénéfice secondaire potentiel et modèle potentiel (exposition à une maladie neurologique au préalable). Le tremblement psychogène a fait l’objet d’une validation séparée démontrant que le signe le plus fiable pour le différencier du tremblement essentiel serait la présence d’une distractibilité (spécificité et sensibilité de 73%) ; le tremblement va changer ou même disparaître lorsque le patient doit se concentrer sur une autre tâche, par exemple le test doigt-nez.
Pour les troubles de la marche et les troubles sensitifs, c’est l’expérience du clinicien qui prime puisqu’il n’existe pas encore de signe clairement validé, bien qu’il y ait un courant pour tester formellement des observations, comme par exemple le tout récent «signe de la chaise» : un groupe de patients avec trouble de la marche psychogène pouvait mieux propulser une chaise sur laquelle ils étaient assis qu’un groupe de patients avec atteinte organique. Pour les troubles sensitifs, c’est la présentation atypique (ne respectant pas un territoire neurologique) qui est un indice classique suggérant un déficit non organique. Le regain d’intérêt pour les troubles neurologiques dissociatifs est donc bien reflété par la pléthore d’articles scientifiques récemment parus qui s’attachent à mieux caractériser et décrire ces signes connus depuis plusieurs siècles et, en parallèle au développement de l’évidence – based médicine (médecine basée sur les faits), à obtenir des signes reproductibles et fiables.
Troubles dissociatifs/de conversion : une maladie psychiatrique ?
Si ces troubles sont donc de mieux en mieux caractérisés, leur cause n’est toujours pas établie avec certitude. Selon le concept freudien, il a été admis qu’il s’agissait d’une maladie psychiatrique avec la résolution du conflit psychique par la production du symptôme somatique. Des études ont en effet établi qu’il existait plus d’événements traumatiques psychiques chez ces patients, plus d’antécédents d’abus physiques et sexuels et qu’ils étaient plus sujets à d’autres troubles psychiatriques, comme la dépression et l’anxiété. Toutefois, il est aussi connu que la mise en évidence d’un tel antécédent n’est pas fiable, notamment du fait de l’évaluation subjective de l’importance du traumatisme éventuel, et une anamnèse d’un «événement stressant» est en fait souvent rapportée également avant l’apparition d’une maladie neurologique organique.
Troubles dissociatifs/de conversion : un corrélat neurobiologique ?
Si l’on admet que la cause première réside en un dysfonctionnement psychique, il n’en reste pas moins que la présentation clinique tout à fait particulière, qui mime parfois très étroitement un déficit neurologique, suggère un dysfonctionnement cérébral. Dès 1995, des études d’imagerie cérébrale par PET et IRM fonctionnelle ont mis en évidence différents modèles d’activation anormaux de certaines régions corticales et sous-corticales. Aucun modèle clair n’est actuellement établi en raison de problèmes méthodologiques; la plupart de ces études n’ont pu être effectuées qu’auprès de petits collectifs de patients, la présentation clinique des troubles dissociatifs étant très hétérogène (différents types de convulsions, parésies ou troubles sensitifs de distribution variées, etc.). Il en ressort toutefois qu’une hyperactivité des régions frontales, secondaire à des phénomènes émotionnels, pourrait à son tour inhiber les régions responsables du symptôme, comme par exemple le cortex précentral moteur lors de troubles moteurs ou pariétaux lors de troubles sensitifs. Ces régions frontales étant impliquées dans la volonté, une perturbation de leur activité pourrait donc empêcher un mouvement volontaire. Une étude sur sept sujets, effectuée lorsque le symptôme (hémi syndrome sensitivo-moteur) était présent et lorsque celui-ci avait récupéré, a montré qu’il existait une hypo activation du thalamus et des ganglions de la base, notamment le noyau caudé, qui récupérait de façon concomitante à la résolution du symptôme. Ceci suggère que des boucles cruciales dans la régulation du mouvement, sont également impliquées dans la production du symptôme somatique dissociatif. Il est dès lors possible que ces boucles soient elles-mêmes sous l’influence du système limbique (impliqué dans la régulation émotionnelle). En effet, il est bien connu que le noyau caudé et le thalamus sont en connexion avec l’amygdale (processus émotionnel) et le cortex orbitofrontal (volonté). Une récente étude s’est attachée à démontrer ce lien potentiel entre la régulation émotionnelle et la production d’un symptôme neurologique : une patiente souffrant d’un hémi syndrome moteur dissociatif a été soumise, pendant l’acquisition d’images par IRM fonctionnelle, à une tâche la forçant à se souvenir d’un événement traumatique (annonce de rupture de la part du conjoint) ; en parallèle à une hyperactivation amygdalienne (témoin de la mise en jeu de la mémoire émotionnelle), il a été observé une hypo activation du cortex moteur situé du côté opposé à son déficit.
Ces inhibitions «actives» de certaines régions cérébrales pourraient alors correspondre à des mécanismes de protection très anciens du point de vue de l’évolution puisqu’il a été observé dans le règne animal des comportements similaires. La réaction de sidération, par exemple, engendrée par la peur, où l’animal ne bouge plus, aurait pour fonction de masquer tout indice potentiel sur sa localisation à un prédateur en attendant la disparition du danger. Un autre exemple de déficit a été observé chez des canards qui apparaissaient malades et boiteux, tout en éloignant lentement un prédateur de leur nid. Ces comportements visant donc à assurer la survie pourraient se retrouver chez l’homme où des déficits, incompréhensibles selon les lois de l’organicité, seraient produits de façon inconsciente afin d’assurer un meilleur équilibre du système interne du corps et, non loin des théories freudiennes, mettre à l’écart un danger psychique ou faire face à une situation extérieure (bénéfice secondaire d’être malade).
Quel potentiel pour un traitement ?
Comme démontré jusqu’ici, de nombreux progrès et efforts ont été effectués pour mieux comprendre tant l’aspect clinique que neurobiologique de cette maladie, mais qu’en est-il des traitements ? Puisqu’aucun modèle définitif n’a été établi, un traitement ciblé n’est pas encore possible. Plusieurs études, souvent non contrôlées ou sur de trop petits collectifs de patients, ont montré un intérêt pour des thérapies cognitivo- comportementales, de la physiothérapie ou encore des médicaments antidépresseurs.
Actuellement, il semble raisonnable d’offrir au patient une prise en charge multidisciplinaire et adaptée à chaque situation individuelle. Il est important d’expliquer au patient qu’il souffre d’une maladie connue et reconnue. Il a été démontré que le terme le mieux accepté par les patients et celui de trouble neurologique fonctionnel. On peut alors, en expliquant que la fonction est perturbée (le contrôle volontaire de la force, par exemple) mais que l’organe est intact (le cerveau et les nerfs), rassurer le patient sur d’autres pathologies graves qu’il pourrait craindre, et envisager un réversibilité des symptômes. Il est alors utile de d’impliquer le patient dans la prise en charge et de lui expliquer l’avantage d’une évaluation et d’un suivi psychiatriques. Il est capital que le patient comprenne qu’on le dirige en psychiatrie, parce justement le diagnostic est positif (pas de lésions organiques) nécessite l’intervention de cette spécialité et non pas parce que par exclusion, voire par dépit, on se tourne vers une autre spécialité.
Enfin, il faut toujours garder à l’esprit que si le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel est un diagnostic positif et non pas d’exclusion, la coexistence d’une pathologie organique est possible ; on observe souvent des patients souffrant d’épilepsie et de crises non épileptiques psychogènes ou encore de patients souffrant de sclérose en plaques et de troubles fonctionnels, comme un tremblement psychogène par exemple. La prise en charge de ces deux pathologies en parallèle sera alors nécessaire.
Conclusion
L’hystérie existe toujours, même si ce terme stigmatisant a été abandonné au profit de termes plus descriptifs (troubles dissociatifs, troubles de conversion, troubles fonctionnels) et représente une pathologie fréquente et invalidante. Même si dans certaines situations, l’établissement d’un diagnostic de certitude reste difficile, de plus en plus de signes cliniques et paracliniques se développent pour aider au diagnostic et le taux d’erreur est bas. Ainsi, le clinicien se doit actuellement de poser un diagnostic positif de conversion et non plus, comme malheureusement souvent dans le passé, évoquer par défaut cette possibilité devant un tableau atypique accompagné d’un bilan paraclinique étendu négatif. Les causes les plus probables concernent des facteurs déclenchants de nature psychiatrique (épisode traumatique ou stress psychique, vulnérabilité avec un terrain d’abus dans l’enfance, comorbidité de troubles anxiodépressifs), ce qui peut à son tour engendrer des modifications du fonctionnement cérébral. La prise en charge de ces patients nécessite un examen approfondi et spécialisé, si possible avec l’aide d’un neurologue, puis une prise en charge psychiatrique, conjointe au suivi somatique. A l’avenir, une meilleure compréhension des mécanismes et des causes la maladie permettra de développer des traitements plus spécifiques.
Implications pratiques
> Une association entre trouble dissociatif et traumatismes a été démontrée
> Il existe des signes neurologiques positifs : manque de concordance entre ce qui est expérimenté, conscientisé et exprimé ou encore fluctuation de la situation clinique
> Une prise en charge conjointe neurologue-psychiatre avec restitution du diagnostic en termes de trouble fonctionnel permet d’établir une alliance thérapeutique
> Les traitements n’ont pas été étudiés mais l’unanimité des médecins retiennent un traitement par psychothérapie